Part II
IV - Canaux logiques
L’interface radio est le maillon faible
de la chaîne transmission. Il faut prévoir un certain nombre de fonctions de
contrôle de nature variée pour que le mobile se rattache à une station de base
favorable, pour établir une communication, pour surveiller son déroulement et
assurer des commutations de cellules en cours de communication (handover).
Ces fonctions engendrent des transferts
de données: informations système, relevés de mesures, messages de contrôles.
Plusieurs canaux logiques ont été définis pour les différents types de
fonction.
L’interface radio permet d’offrir un
certain nombre de tuyaux numériques:

D’une manière plus générale, il faut
prévoir une multitude de fonctions de contrôle, en particulier :
![]() diffuser
des informations système (cf. Broadcoast Control CHannels)
diffuser
des informations système (cf. Broadcoast Control CHannels)
![]() prévenir
les mobiles des appels rentrant et faciliter leur accès au système (cf. Common
Control Channel)
prévenir
les mobiles des appels rentrant et faciliter leur accès au système (cf. Common
Control Channel)
![]() contrôler
les paramètres physiques avant et pendant les phases actives de transmission
(cf. FACCH, SCH et SACCH)
contrôler
les paramètres physiques avant et pendant les phases actives de transmission
(cf. FACCH, SCH et SACCH)
fournir
des supports pour la transmission de signalisation téléphonique (cf. SDCCH).
|
TYPE |
NOM |
FONCTION |
DEBIT |
|
Broadcoast
CHannel : BCH (↓) |
Frequency
Correction CHannel : FCCH (↓) |
Calage sur fréquence porteuse |
148 bits toutes les 50 ms |
|
Synchronisation CHannel : SCH (↓) |
Synchronisation (en temps) +
Identification |
148 bits toutes les 50 ms |
|
|
Broadcoast
Control Channel : BCCH (↓) |
Information système |
782 bit/s |
|
|
Common Control Channel : CCCH (↓)
(↑) |
Paging
CHannel : PCH
(↓) |
Appel du mobile |
456 bits par communication |
|
Random
Access Channel : RACH (↑) |
Accès aléatoire du mobile pour effectuer une opération sur le
réseau |
36 bits par messages |
|
|
Access Grant Channel : AGCH
(↓) |
Allocation de ressources |
456 bits par message d’allocation |
|
|
Cell
Broadcoast Channel : CBCH (↓) |
Messages courts (SMS) diffusés
(informations routières, météo…) |
Débit variable |
|
|
Dedicated Control Channel DCCH (↓) |
Stand-Alone
Dedicated Control CHannel : SDCCH
(↓) |
Signalisation |
782 bit/s |
|
Slow
Associated Control CHannel : SACCH (↓) |
Supervision de la ligne |
382bit/s pour de la parole 391 bit/s pour la signalisation |
|
|
Fast
Associated Contol CHannel : FACCH (↓) |
Exécution du handover |
9.2 kbit/s ou 4.6
kbit/s |
|
|
Trafic
CHannel TCH (↓) |
Trafic
CHannel for coded speech : TCH (↓) |
Voix plein/demi débit |
13 kbit/s (plein débit) 5.6 kbit/s (demi-débit) |
|
Trafic
CHannel for data (↓) |
Données utilisateur |
9.6kbit/s, 4.8 kbit/s ou 2.4 kbit/s |
IV.a – Fréquence balise (beacon channel)
Le réseau GSM s’appui sur le concept
de la voie balise qui est choisie parmi les porteuses
attribuées à l’opérateur :
1.
Elle est
propre à la station de base.
2.
Elle est
émise en permanence.
3.
Le MS mesure
périodiquement sur cette voie le niveau de signal qu’il reçoit
4.
Le MS
mesure son éloignement de la station.
5.
La voie
balise comprend essentiellement des signaux de forme spécifique et des infos
systèmes qui permettent de savoir :
a.
Identité du
réseau
b.
Calage en
fréquence
c.
Calage en
temps
6.
Scrustation
en permanence
7.
Fréquence
descendante
a.
Emission en
permanence d’un signal modulé en puissance
b.
Ensemble de
canaux logiques BCH (Broadcast Channel)
IV.b – Les canaux logiques non dédiés
Canaux simplex, partagés par un ensemble
de mobiles.
Sur la voie descendante (en générale la
voie balise) les Ms sont à l’écoute du canal.
Sur la voie montante, on retrouve la fonction d’accès multiple. L’Aloha slotté est utilisé. Le slot supportant la fonction d’accès aléatoire (Random Access) est à priori disponible à un ensemble de mobiles. Chacun peut émettre et les collisions sont résolues par les méthodes classiques de résolution de contentieux.
Sur la voie balise Slot 0, on y retrouve
FCCH, SCH, BCCH, AGCH, PCH,CBCH.
IV.b.1 - FCCH (Frequency
Correction Channel)
Consiste en 1 burst particulier émis
environ toutes les 50 ms. Le message est 148 bits à 0 (67.7 kHz). Règle le
décalage en fréquence du à la modulation GMSK (Gaussian
minimum-shift keying) (F0
+1625/24 kHz).
La phase varie linéairement pendant un temps bit :
Ø Si bit = 0 +Π/2 à la
fin du bit
Ø Si bit = 1 -Π/2 à la
fin du bit
Cela crée un déplacement de fréquence qui
occasionne un décalage de 67.7 kHz.
IV.b.2 - SCH (Synchronisation Channel)
Il a pour objet de fournir aux mobiles
tous les éléments nécessaires à une synchronisation complète ; il
caractérise la voie balise par un marquage spécial (séquence
d’apprentissage) :
ü Synchronisation fine : aide à la
détermination du TA
ü Synchronisation logique :
détermination du FN (Frame Number). Il s’agit de mettre le compteur de trame FN
mobile avec celui de la BS.
Il est possible que l’on arrive à chopper le signal sur 2 balises éloignées (même fréquence). Il faut donc le différencier par le BSIC (3bits d’identification de la BTS, 3 bits d’identification du réseau).
IV.b.3 - BCCH (Broadcast
Control Channel)
Diffuse les données caractéristiques de
la cellule ;
Diffusion régulières d’informations
systèmes de plusieurs types ;
Contient les règles d’accès à la cellule.
Permet au mobile s’il peut se mettre en veille sur la cellule, après une mise
sous tension ou après y être entrer (Niveau minimal de signal exigé, niveau
maximal de puissance autorisé, hystérésis nécessaire pour la re-sélection de
cellules (2 dif/seconde) ;
Le numéro de zone de localisation permet
au mobile de savoir si une inscription est nécessaire. (2 dif/seconde).
Les paramètres RACH donnent les règles d’accès aléatoire. De plus, ils permettent d’interdire une cellule à tous les mobiles et de la réserver par exemple uniquement à l’accueil de handover (4 dif/seconde).
D’autres informations diffusées chaque
seconde, permettent aux mobiles de se mettre en conformité avec l’organisation
de la cellule :
ü Description de l’organisation des canaux de
contrôle commun indique aux MS les slots à écouter pour détecter les appels
diffusés.
ü La description de l’organisation du canal
CBCH permet au MS de recevoir les messages utilisateurs diffusés.
ü La description des cellules voisines donne
les fréquences des voies balises des cellules voisines.
ü La liste des porteuses allouées à la BS
est nécessaire au MS lorsqu’il est en communication et que le saut de fréquence
est activé.
ü De plus, un ensemble de paramètres
nécessaire à différentes fonctions liées au déroulement des communications est
diffusé : Contrôle de puissance, valeur de hors temp.
ü Chaque BS diffuse également son identité
complète (CI, Cell Identity) au sein de la zone de
localisation.
IV.b.4 - RACH (Random Access
Channel)
Si
le mobile veut effectuer une opération sur le réseau (localisation, envoi de
messages courts, appel d’urgence, appel normal…), ils doivent le signaler au
réseau. Pour cela, ils envoient une requête très courte codée sur un seul burst
vers la BS. Cette requête est envoyée sur des slots particuliers en accès
aléatoire de type ALOHA synchronisé, l’ensemble de ces slots constitue le RACH.
Le burst utilisé est plus court que le normal pour tenir compte du délai de
propagation.
IV.b.5 - AGCH (Access Grant Channel)
Lorsque
l’infrastructure reçoit une requête de la part d’un mobile, il faut allouer un
canal de signalisation dédié pour identifier le mobile. Le message d’allocation
contient la description complète du canal de signalisation utilisé : N° de
porteuse et N° de slot.
IV.b.6 - PCH (Paging
Channel)
Lorsque
l’infrastructure désire communiquer avec un mobile (pour un appel, un message
court, une authentification), elle diffuse l’identité du mobile, sur un
ensemble de cellules. Le mobile répond par un RACH sur la cellule où elle est.
IV.b.7 - CBCH (Cell
Broadcast Channel)
Permet
de diffuser aux usagers présents dans la cellule des informations spécifiques
(info routière, météo…). Utilisation marginale.
IV.c - Les canaux de contrôle logiques dédiés
Ces canaux fournissent une ressource
réservée à un mobile. Sur une paire de fréquence, un slot parmi 8 est alloué à
une communication avec un mobile donné. Cette paire de slots forme un canal physique duplex.
Le mobile se voit attribuer dans une
structure multitrame une paire de slots (↑↓) dans
lequel il est le seul à transmettre et à recevoir.
Dans la même cellule, aucun autre mobile
ne peut transmettre, ni recevoir dans le même slot et à la même fréquence.
Ce dernier forme la base de deux canaux logiques
; d’abord le TCH (Trafic CHannel) qui porte la voie
numérisée, mais aussi un petit canal de contrôle, le SACCH ( Slow Associated Control Channel) qui
permet principalement le contrôle des paramètres physiques de la liaison.
Sur
un canal physique on peut placer soit :
ü TCH avec son SACCH associé (multitrame 26
(12 ->S, 25->i))
ü SDCCH avec SACCH associé. (multitrame 51)
IV.c.1 - TCH (Trafic Channel)
La parole est
transportée par le TCH :
1.
13 kbit/s
(TCH/FS) Plein débit.
2. 5.6 kbit/s
(TCH/HS) Demi débit.
3. Données 12
kbit/s.
IV.c.2 – SDCCH (Stand Alone
Dedicated Control Channel)
Canal
de signalisation, avec un débit plus faible 800 bit/s. On a un environ un SDCCH
pour 8 TCH.
IV.c.3 – SACCH (Slow
Associated Control Channel)
Une
liaison radio est fluctuante, il n’est pas possible de dédier un canal à un MS
sans le contrôler en permanence. Il faut constamment ajuster les paramètres
pour conserver une qualité de service acceptable. Enfin le réseau doit vérifier
que le mobile est toujours actif sur le canal. Son débit est faible et le délai
important (½ seconde). On y retrouve :
1. TA.
2. Contrôle de puissance d’émission du
mobile.
3. Contrôle de la qualité du lien radio.
4. Rapatriement des mesures effectuées sur
les stations voisines
IV.c.4 – FACCH (Fast Associated
Control Channel)
Le
SACCH est trop lent en cas d’urgence sur un TCH (par exemple handover), donc on
suspend l’émission de la TCH et on envoie le FACCH à la place. Le SDCCH est
suffisamment rapide, donc pas besoin FACCH.
IV.d – Scrutation
Pendant
une communication, le mobile ne se contente pas de recevoir et d’émettre une
trame TDMA à la suivante. Il met à profit la durée disponible entre l’émission
et la réception d’un burst, pour scruter la fréquence balise des cellules
avoisinantes. Il ne peut faire, pendant cette phase appelée Monitoring que des mesures de puissance qui ne
nécessitent pas de démodulation complète.
IV.e – Groupes de trames
Les trames TDMA sont groupées en trame
dite multitrame :
![]() Multitrame26 : 26 trames TDMA
d’une durée de 120ms. Cette mulitrame supporte le TCH avec leur SACCH et FACCH.
Multitrame26 : 26 trames TDMA
d’une durée de 120ms. Cette mulitrame supporte le TCH avec leur SACCH et FACCH.
![]() Multitrame51 : 51 trames TDMA
d’une durée de 235.4ms. Cette multitrame supportent les canaux SDCCH et les
canaux communs.
Multitrame51 : 51 trames TDMA
d’une durée de 235.4ms. Cette multitrame supportent les canaux SDCCH et les
canaux communs.
Les supertrames contiennent 26*51 =1326 trames TDMA et dure 6.12s (26 trames de 51 ou 51 trames de 26).
Une hypertrame contient 2048 supertrames (soit 2175 648 TDMA). Elle dure 3h 28min 53s 760ms.
Chaque trame TDMA à l’intérieur d’une hypertrame est identifié bijectivement par un numéro appelé FN (Frame Number, de 0 à 2 715 647)
IV.f – Spectres caractéristiques
A l’analyseur de spectre, nous pouvons
visualiser les différents signaux échangés.
Nous passons une communication GSM, avec une voie balise (BCH) sur le canal 21 (939.2 MHz), qui nous autorise un dialogue sur le canal TCH 62 (902.4 MHz ↑, 947.4 MHz ↓).
Ainsi sur la bande descendante, nous visualisons les 2 raies :
![]() Une d’amplitude constante (en
temporelle puissance constante) la BCH.
Une d’amplitude constante (en
temporelle puissance constante) la BCH.
![]() Une d’amplitude intermittente (en
temporelle nous retrouvons la trame TDMA donc bursté), la TCH.
Une d’amplitude intermittente (en
temporelle nous retrouvons la trame TDMA donc bursté), la TCH.
Dans la bande montante, nous visualisons de même la raie burstée sur le slot 0.
V.Scénario
V.a – Veille
Une MS sous tension doit pouvoir recevoir des appels. Le mobile est alors en état de veille (idle). Elle doit se caler sur une cellule, écouter une voie balise et surveiller son environnement.
V.b – Sélection de cellules
Le mobile n’a pas de renseignement :
v Elle doit écouter l’ensemble des
porteuses du système (124 pour GSM) et mesurer le champ reçu en réalisant une
moyenne sur plusieurs mesures. (5 mesures sur 3 secondes).
v Sélection sur liste en mémoire des voies
balises (BCCH) du PLMN sélectionné.
V.c – Etudes des voies balises candidates
Le mobile choppe la voie la plus forte
puis :
v Vérifie le PLMN.
v Regarde si la cellule est autorisée (Pas
de surcharge)
v Affaiblissement correcte entre MS et BTS
Si
la cellule est convenable, la MS lit l’identité de la zone de localisation et
s’inscrit si nécessaire. Une fois l’inscription acceptée, elle se cale sur la
voie balise en attente d’un appel éventuel et en surveillance constante pour
détecter une sortie de cellules
V.d – Calage sur une cellule
v
La MS
reçoit les informations systèmes sur BCCH.
v
Elle peut
établir la communication via RACH.
v
Elle écoute
PCH pour surveiller les messages d’appel.
v
BCCH
indique les porteuses BCCH à étudier (liste établie par l’opérateur).
v
Mobile
mesure le champ de chaque BCCH (5 mesures pour 5 secondes). Et liste les 6 cellules
les plus puissantes ;
v
Le mobile
doit essayer de décrypter les informations système toutes les 30 secondes sur
le cellule en service et toutes les 5minutes sur les 6 les plus puissantes.
V.e – Processus de resélection de cellules
La
sélection de la cellule est faite si le MS détecte une puissance sur une
BCCH :
A =Pr –Pé >0
La cellule sélectionnée est celle qui
possède le A le plus élevé.
Toutes
les 5 secondes, le mobile voit :
![]() Si C1 (+ forte puissance) est trop
faible.
Si C1 (+ forte puissance) est trop
faible.
![]() MS ne reçoit plus de messages de
signalisation sur la voie descendante.
MS ne reçoit plus de messages de
signalisation sur la voie descendante.
![]() La cellule sélectionnée est passée dans
l’état interdit.
La cellule sélectionnée est passée dans
l’état interdit.
![]() Il existe une meilleure cellule.
Il existe une meilleure cellule.
![]() Une tentative d’accès aléatoire est
infructueuse après le nombre maximal de transmission autorisée.
Une tentative d’accès aléatoire est
infructueuse après le nombre maximal de transmission autorisée.
V.f – Perte de signalisation descendante
Parfois C1 ne suffit pas car il n’a pas la qualité suffisante (C/I), la MS doit écouter le canal PCH et donc décoder les messages émis sur ce canal. Pour avoir une idée de la qualité de la communication, elle fait une analyse de messages non décelables. Lorsque ce nombre atteint un certain seuil (paramétrable, diffusé sur BCCH), la MS tente une resélection de cellules.
V.g – Contrôle de puissance
Le
BCCH donne l’indication au mobile de la première puissance d’émission.
C’est
le réseau qui indique la puissance Max (la même pour tous les canaux).
L’information est donné via SACCH -> MS s’adapte à raison de
2dbm/60ms -> MS retourne puissance via SACCH.
V.h – DTX
Au niveau CODEC, le DTX permet au MS d’être
inactif pendant les silences de parole. Le but est de réduire le débit de
codage à 500bit/s quand l’usager n’est pas en train de parler (débit suffisant
pour le bruit de fond).
On passe de 260 bits/20ms à
260bits/480ms.
Il faut un détecteur d’activité locale,
une évaluation du bruit de fond côté émetteur et la génération d’un bruit de
confort pendant les périodes où la transmission radio est interrompue (Au lieu
de TCH, on SID qui trament les bruits de fond.
VI.Gestion de la sécurite du
réseau et des appels
L’introduction de la mobilité dans les
réseaux GSM a nécessité la création de nouvelles fonctions par rapport aux
réseaux fixes classiques.
Le système doit pouvoir connaître à tout
moment la localisation d’un abonné de façon plus ou moins précise. En effet,
dans un réseau fixe, à un numéro correspond une adresse physique fixe (une
prise de téléphone), alors que pour le réseau GSM, le numéro d’un terminal
mobile est une adresse logique constante à laquelle il faut associer une
adresse physique qui varie au gré des déplacements de l’usager du terminal.
La gestion de cette itinérance nécessite
la mise en œuvre d’une identification spécifique de l'utilisateur.
De plus, l'emploi d’un canal radio rend
les communications vulnérables aux écoutes et aux utilisations frauduleuses.
Le système GSM a donc recours aux
procédés suivants :
v authentification de chaque abonné avant
de lui autoriser l’accès à un service,
v utilisation d’une identité temporaire,
v chiffrement (ou cryptage) des
communications.
VI.a - Numérotation liée à la mobilité
Le système GSM utilise quatre types
d’adressage liés à l’abonné :
v L’IMSI (identité
invariante de l’abonné) n’est connu qu’à l’intérieur du réseau GSM ; cette
identité doit rester secrète autant que possible, aussi, GSM a recours au TMSI,
v Le TMSI est une
identité temporaire utilisée pour identifier le mobile lors des interactions
Station Mobile / Réseau. A l’intérieur d’une zone gérée par un VLR, un abonné
dispose d’une identité temporaire. Le TMSI, codé sur 4 octets, est attribué au
mobile de façon locale, c’est-à-dire uniquement pour la zone gérée par le VLR
courant du mobile. Le TMSI est utilisé pour identifier le mobile appelé ou
appelant lors de l’établissement d’une communication.
v Le MSISDN est le
numéro de l’abonné; c’est le seul identifiant de l’abonné mobile connu à
l’extérieur du réseau GSM,
v Le MSRN est un
numéro attribué lors de l’établissement d’un appel. Sa principale fonction est
de permettre l’acheminement des appels par les commutateurs (MSC et GMSC).
Exemple de mise en œuvre des différentes identités d’abonné dans GSM lors d’un appel entrant:
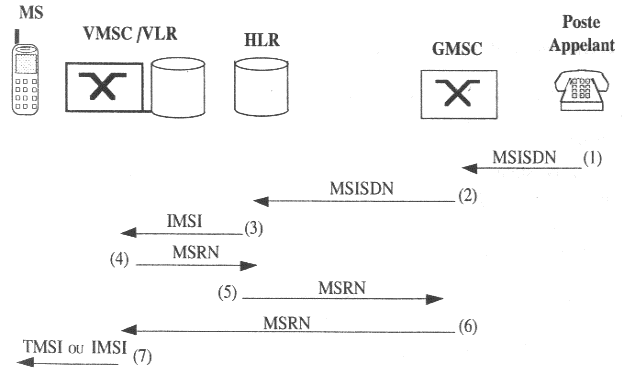
VI.b - Authentification et chiffrement
A cause de l’utilisation du canal
radioélectrique pour transporter les informations, les abonnés sont
particulièrement vulnérables :
v à la possibilité d’utilisation frauduleuse
de leur compte par des personnes disposant de mobiles
"pirates", qui se présentent avec l’identité d’abonnés autorisés,
v à la possibilité de voir leurs
communications écoutées lors du transit des informations sur le canal radio. Le
système GSM intègre donc des fonctions de sécurité visant à protéger à la fois
les abonnés et les opérateurs
v confidentialité de l’IMSI,
v authentification d’un abonné pour
protéger l’accès aux services,
v confidentialité des données usager,
v confidentialité des informations de
signalisation.
VI.C - Confidentialité de l’identité de l’abonné
Il s’agit d’éviter l’interception de
l’IMSI lors de son transfert sur la voie radio par des entités non autorisées.
Ainsi, il devient difficile de suivre un abonné mobile en interceptant les
messages de signalisations échangés.
Le meilleur moyen d’éviter l’interception
de l’IMSI est de la transmettre le plus rarement possible. C’est pourquoi le
système GSM a recours au TMSI et c’est le réseau qui gère des bases de données
et établit la correspondance entre IMSI et TMSI.
En général, l’IMSI est transmise lors de
la mise sous tension du mobile et ensuite les TMSIs successives du mobile
seront transmises. Ce n’est qu’en cas de perte du TMSI ou lorsque le VLR
courant ne la reconnaît pas (par exemple après une panne) que l’IMSI peut être
transmise.
L’allocation d’une nouvelle TMSI est
faite au minimum à chaque changement de VLR, et suivant le choix de
l’opérateur, à chaque intervention du mobile. Son envoi à la station mobile a
lieu en mode chiffré.
VI.d - Principes généraux d’authentification et de chiffrement
Pour mettre en œuvre les fonctions
d’authentification et de chiffrement des informations transmises sur la voie
radio, GSM utilise les éléments suivants :
v des nombres aléatoires RAND,
v une clé Ki pour l’authentification et la
détermination de la clé Kc
v un algorithme A3 fournissant un nombre
SRES à partir des arguments d’entrée RAND et de la clé Ki,
v un algorithme A8 pour la détermination de
la clé Kc à partir des arguments d’entrée RAND et Ki,
v un algorithme A5 pour le chiffrement /
déchiffrement des données à partir de la clé Kc.A chaque abonné est attribué
une clé Ki propre. Les algorithmes A3, A5 et A8 sont quant à eux les mêmes pour
tous les abonnés d’un même réseau.
L’utilisation de ces différents éléments
pour la mise en œuvre des fonctions de sécurité peut être schématisée par la
figure suivante:

VI.e - Authentification de l’identité de l’abonné
L’authentification de l’identité de l’abonné peut être exigée du mobile par le réseau à chaque mise à jour de localisation, à chaque établissement d’appel et avant d’activer ou de désactiver certains services supplémentaires.
Dans le cas où la procédure d’authentification de l’abonné échouerait, l’accès au réseau est refusé au mobile. Le déroulement global de la procédure est le suivant : -
v le réseau transmet un nombre aléatoire RAND au mobile 0;
v la carte SIM du mobile calcule la signature de RAND grâce à l’algorithme A3 et la clé Ki. Le résultat calculé, noté SRES, est envoyé par le mobile au réseau;
v le réseau compare SRES au résultat calculé de son coté. Si les deux résultats sont identiques, l’abonné est identifié.
Ce déroulement peut être schématisé par la figure suivante :

La confidentialité des données permet d’interdire
l’interception et le décodage des informations par des entités non autorisées;
elle sert plus particulièrement à protéger les éléments suivants :
o IMEI (identité du terminal),
o IMSI (identité de l’abonné) et numéro
appelant ou appelé. Cette confidentialité est obtenue grâce au chiffrement des
données. Elle ne concerne que les informations circulant sur l’interface MS /
BTS.
La procédure de chiffrement fait
intervenir les éléments suivants : l’algorithme de chiffrement, le mode
d’établissement de la clé de chiffrement et le déclenchement des processus de
chiffrement / déchiffrement à chaque bout de la liaison.
Etablissement de la clé
Les informations transmises sur les
canaux dédiés sont chiffrées grâce à la clé Kc calculée à partir du nombre aléatoire
RAND et de l’algorithme A8 selon la figure suivante :

Activation du chiffrement
L’algorithme A5 est implanté dans la BTS.
L’activation se fait sur demande du MSC mais le dialogue est géré par la BTS.
On peut noter que ce chiffrement ne peut
être activé dès les premiers messages mais se fait après une procédure
d’authentification puisqu’il nécessite la connaissance de la clé Kc par le
mobile.
Gestion des données de sécurité au sein
du réseau
Gestion de la clé d’authentification Ki
La clé Ki est attribuée à l’usager, lors
de l’abonnement, avec l’IMSI. Elle est stockée dans la carte SIM de l’abonné et
dans l’AUC au niveau du réseau. Afin de limiter les possibilités de lecture de
la clé Ki, celle-ci n’est jamais transmise à travers le réseau, ni sur
l’interface radio, ni entre les équipements fixes.
Entités du réseau où sont enregistrées
les données de sécurité
Le centre d’authentification AUC stocke
l’algorithme d’authentification A3, l’algorithme de génération de la clé de
chiffrement A8 et les clés Ki des différents abonnés du réseau GSM.
Le HLR peut stocker plusieurs triplets
(Kc, RAND, SRES) pour chaque IMSI. Dans le VLR plusieurs triplets (Kc, RAND,
SRES) sont enregistrés pour chaque IMSI. Les couples TMSI (ou IMSI) et la
clé de chiffrement Kc le sont aussi.
La BTS peut stocker l’algorithme de
chiffrement A5 pour les données usager et pour les données de signalisation.
La station mobile contient dans la carte
SIM de l’abonné : l’algorithme d’authentification A3, l’algorithme de
chiffrement A5, l’algorithme de génération des clés de chiffrements A8, la clé
d’authentification individuelle de l’utilisateur Ki, la clé de chiffrement Kc,
le numéro de séquence de la clé de chiffrement et le TMSI.
Les mécanismes de sécurité mis en œuvre
dans GSM permettent d’obtenir des niveaux de protection très élevés pour le
système et pour les abonnés. En effet il faudrait par exemple plusieurs
milliards de couples (RAND, SRES) afin de déterminer l’algorithme A3.
Mais aucun système de sécurité n'est
fiable à 100%. On a donc recours à des systèmes de sécurité internes propres
aux terminaux mobiles.
L’opérateur du réseau GSM peut vérifier
l’identité IMEI d’un terminal. Si celle-ci n’est pas reconnue par le réseau ou
si elle fait partie d’une liste de terminaux dérobés ou pirates, l’accès du
mobile au réseau est alors refusé. Le réseau peut aussi mémoriser l’identité
IMSI de l’abonné utilisant le terminal douteux.
Il est intéressant de noter que la carte
SIM contient également des codes personnalisables par l’usager et
utilisés pour identifier l’abonné, tel le code PIN, Personnal Identity
Number, demandé à l’utilisateur à chaque mise sous tension du terminal.
La carte peut aussi contenir d’autres
codes selon la volonté de l’utilisateur, afin d’interdire l’accès à certains
services.
VI.f - Alimentation
VI.f.1 - La batterie nickel-cadmium (NiCd)
C'est la première technologie apparue sur le marché; ses points faibles : le poids et "l'effet mémoire". En effet, pour une utilisation optimale de votre batterie, il faut la décharger complètement avant de la recharger. Si vous ne respectez pas cette procédure, votre batterie va perdre en capacité. Sa durée de vie est d'environ 1000 cycles (charges).
VI.f.2 - La batterie nickel- métal hydrure (NiMH)
C'est actuellement la batterie la plus
vendue avec les téléphones portables, cette technologie permet une
capacité et un rendement supérieurs au nickel cadmium, son point fort : elle ne
possède pas "d'effet mémoire". Sa durée de vie est d'environ 700
cycles.
VI.f.3 - La batterie au Lithium
Elle offre le meilleur rapport énergie/poids avec une autonomie très importante, son prix est assez élevé par rapport aux autres. Sa durée de vie est d'environ 400 cycles.
VII Autres applications
VII.a – GPRS
Le GPRS (General
Packet Radio Service) est un service non vocal
qui permet d’envoyer des informations à travers le réseau GSM. On transmet des
paquets (plus de débit, en utilisant moins de fréquence).
A
terme l’usager payera le nombre de paquet (service utilisé, nombre de bits…) et
non plus la durée de communication. Cela n’a rien avoir avec le GPS. Ce système
permet un développement plus important du GSM mais reste limité pour des
raisons de coût (ce n’est rien comparé à l’UMTS)
VII.a.1 – Utilisateur
![]() Vitesse
Vitesse
La vitesse théorique en utilisant les 8 slots en
même temps est de 171.2 kilobits/s. C’est trois fois plus rapide que sur les
réseaux téléphoniques actuelles et 10 fois plus rapides que le GSM. Comme il
est plus rapide, il revient moins cher que le SMS.
![]() Facilité
Facilité
Les informations arrivent sans avoir besoin de
composer un numéro (modem). On peut l’associer à l’idée de “toujours
connecté”. En plus, on introduit la notion de communication machine à
machine, ce qui nous ouvre tout grand les portes de l’internet.
![]() Accès aux services
Accès aux services
Nous avons besoin :
·
Une MS ou un terminal qui gère le GPRS (ce qui n’est pas le
cas actuellement)
· S’inscrire chez un fournisseur.
· Avoir les logiciels associés.
VII.a.2 – Réseau
Il faut adapter les réseaux existants au GPRS
(analogie à internet)
![]() Spectre Hertzien
Spectre Hertzien
On utilise les ressources radio quand on émet ou
on reçoit des données. Donc c’est mieu et en plus on ne modifie rien.
![]() Réseau
local
Réseau
local
Grand chambardement car on complète le
dispositif actuel, en particulier pour accéder à d’autres réseaux.
On introduit 3 éléments nouveaux dans l’infrastructure :
1.
SGSN
(Serving GPRS Support Node). IL pilote les paquets de données entre les 2
abonnés, la gestion de la mobilité, l’identification
et le codage. Le trafic entre la SGSN et le MS suit ensuite la voie normale du
GSM (BSC+BTS).
2.
GGSN (Gateway GPRS
Support Node). C’est un accès
aux réseaux extérieurs (gestion des adresses IP) sur une base de données
dynamiques.
3.
PTM-SC (Point-to Multipoint Service Centre). Traite le
trafic entre le réseau GPRS principal et le HLR.
Tous les nœuds sont liés par un IP au réseau principal.
VII.a.3 - limites
Le GPRS sera un nouvel outil nécessaire
pour le future, mais sa mise en oeuvre doit respecter certaines
limitations :
Ø
Les cellules ont une capacité limitée
Le GPRS doit s’inclure dans le dispositif actuel. Les
ressources radio sont limitées. Il est souhaitable de réserver des slots au
GPRS et donc de gérer dynamiquement les allocations de canaux. On a donc besoin
du SMS pour avoir d’autres ressources radio.
Ø
On est plus lent en pratique
Car il faut
gérer les erreurs de transmission.. au lieu des 8 time slots théoriques, on en
utilisera que 2 ou 3..
Ø
Une modulation optimale
GPRS est basé
sur la modulation GMSK. EDGE est base sur une nouvelle modulation qui permet d’augmenter le nombre de bits sur l’interface radio (eight-phase-shift keying
modulation (8 PSK)). L’UMTS utilise cette technique donc les opérateurs
devront inclure cette nouvelle modulation..
VII.b – WAP (Wireless Application
Protocol)
Wireless Application Protocol. Dans le
domaine des transferts de données, le WAP est un protocole dont le but est de
faciliter la communication entre le système informatique et un GSM. Il concerne
notamment les liens entre Internet et les mobiles.
Il s’agit d’une approche de type Client/
Serveur. On introduit un browser dans le MS adapté à celui ci. Il réside en
fait sur le serveur de manière temporaire. L ‘idée générale est d’utiliser le moins de ressources
possible du MS.
C’est pourquoi, on a remplacé le HTML (HyperText
Markup Language) d’internet, par le HDML (Handheld Device Markup Language) et
la gestion téléphonique HDTP (Handheld Device Transport Protocol). Le serveur
fera le lien et l’adaptation avec l’internet ou l’intranet :
o On fait une requête en WML (Wireless
Markup Language), un langage dérivé du HTML.
o Cette requête
transite par une passerelle Wap et est mis au format HTML.
o L’architecture
de WAP est la suivante :
|
Wireless Application
Environment (WAE) |
Interface utilisateur.sur
le MS :Supporte le WML, WMLScript (analogue a javaScript) et WTA
(Wireless Telephony Application) |
|
Wireless Session Protocol (WSP) |
|
|
Wireless Transaction Protocol (WTP) |
|
|
Wireless Transport Layer Security (WTLS) |
|
|
Wireless Datagram Protocol (WDP) |
|
|
Bearers e.g. Data, SMS, USSD |
|
VII.c – SMS (Short Message Service)
Le SMS fait
partie des premiers standards de la norme GSM et permet d’envoyer des messages
courts (~160 caractères) d’un ordinateur vers un mobile.
Il s’est
échangé en Europe en avril 99 environ 1 milliard de SMS (200 millions pour les
fritzs, 75 pour les rosbeefs et 60 millions pour nous).
Le marché est
boosté par la communication d’entreprise (25%) et la possibilité d’avoir un
Email sans ordinateur (idéal pour les pays peu équipés) (20%), sans compter sur
les messages à caractère informatif (météo..) 20%.
Mais 90% des
messages restent de mobile vers mobile (bonjour, ça va…) et il reste plus
pratique que le mail. Via le LAN (Local Area Networks), on peut être joint a
tout moment et partout.
L’opérateur
utilise ce moyen pour prévenir la présence de message sur le répondeur, le fax
ou autre.
Son successeur
direct est le GPRS qui est nettement plus rapide bien que la taille des
messages pour l’instant envoyé rend ce service un peu gadget. Sa mort est
programmée pour 2005.
Et puis avec le
WAP on fera beaucoup mieux (message plus long, possibilité de stockage sur le
réseau...).
VII.d – UMTS
VII.d.1 - Introduction
L’UMTS est
présenté comme la troisième révolution de l’information après la télévision
(spectateur passif), l’internet qui permet de chercher l’information mais qui
la contrainte des terminaux fixes, et les portables où l’on peut accéder aux
informations n’importe où sur la planète.
Les mobiles de la troisième génération seront des terminaux aux débits de loin supérieurs à ceux de nos portables actuels, avoisinant au maximum de leurs possibilités à peu près 2Mbit/sec. Ils ne se limiteront pas au transfert de la voix : ils pourront également offrir une gamme presque infinie de services multimédias. Enfin ils ont pour ambition de proposer au consommateur un service accessible depuis n’importe quel pays, abstraction faite de toute norme et particularisme régional.
VII.d.2 - Contraintes sur
l’interface radio
![]() Conçu
pour accueillir une large gamme de services (Transfert à des taux 2MB/sec pour
100kb/sec pour le GSM).
Conçu
pour accueillir une large gamme de services (Transfert à des taux 2MB/sec pour
100kb/sec pour le GSM).
![]() Gestion
de la multicouche : Interaction entre des macrocellules (de 0,5 à 10 km de
rayon) pour la couverture globale, des microcellules (de 50 à 500 mètres) pour
les fortes densités de trafic en ville et des picocellules (de 5 à 50 mètres),
pour la couverture à l'intérieure des bâtiments. Le changement de cellules (handover)
devra se faire de façon transparente, c'est-à-dire sans coupure perceptibles
pour l'utilisateur, ni pertes de données.
Gestion
de la multicouche : Interaction entre des macrocellules (de 0,5 à 10 km de
rayon) pour la couverture globale, des microcellules (de 50 à 500 mètres) pour
les fortes densités de trafic en ville et des picocellules (de 5 à 50 mètres),
pour la couverture à l'intérieure des bâtiments. Le changement de cellules (handover)
devra se faire de façon transparente, c'est-à-dire sans coupure perceptibles
pour l'utilisateur, ni pertes de données.
![]() Coexistance avec la deuxième
génération (transopérabilité). Financièrement ça coûte une fortune et il faut
déjà amortir les installations de la 2ième génération (GSM). La
nécessité de réaliser des terminaux bimodes (GSM-UMTS) à bas coût impose
quelques contraintes sur le choix des paramètres , notamment la largeur des
porteuses, qui doivent être multiples de 200 kHz (on l’a déjà vu plus haut), et
sur les débits utilisés, qui doivent pouvoir être dérivés d'une horloge commune avec celle du GSM (13
ou 26 MHz.
Coexistance avec la deuxième
génération (transopérabilité). Financièrement ça coûte une fortune et il faut
déjà amortir les installations de la 2ième génération (GSM). La
nécessité de réaliser des terminaux bimodes (GSM-UMTS) à bas coût impose
quelques contraintes sur le choix des paramètres , notamment la largeur des
porteuses, qui doivent être multiples de 200 kHz (on l’a déjà vu plus haut), et
sur les débits utilisés, qui doivent pouvoir être dérivés d'une horloge commune avec celle du GSM (13
ou 26 MHz.
![]() Bandes de fréquence : Une
première tranche se situe entre 1885 Mhz et 2025 Mhz et une seconde entre 2110
MHz et 2200 MHz. Dans la bande terrestre; 2x60 mhz sont appariés pour une
opération en mode FDD principalement , tandis que 50 MHz sont non-appariés et
devront être traités en mode TDD.
Bandes de fréquence : Une
première tranche se situe entre 1885 Mhz et 2025 Mhz et une seconde entre 2110
MHz et 2200 MHz. Dans la bande terrestre; 2x60 mhz sont appariés pour une
opération en mode FDD principalement , tandis que 50 MHz sont non-appariés et
devront être traités en mode TDD.
![]() La enième comission de normalisation a
proposé le concept UTRA UTRA (UMTS
Terrestrial Radio Interface). Celui-ci est un compromis entre deux modes:
La enième comission de normalisation a
proposé le concept UTRA UTRA (UMTS
Terrestrial Radio Interface). Celui-ci est un compromis entre deux modes:
1.
le mode W-CDMA, utilisé en FDD (Frequency Domain
Duplex, c'est-à-dire une fréquence par sens de transmission). Le concept W-CDMA
utilise une technique d'étalement de spectre par séquence directe. Tous les
utilisateurs émettent sur un même canal radioélectrique à large bande, mais ils
sont distingués par une séquence d'étalement pseudo-aléatoire, appelée code et
connue du récepteur (technique mise au point pour le GPS). Le débit maximal
supporté par un seul code est de 384 kbit/sec. Pour les services à plus haut
débit, plusieurs codes sont alloués à un même utilisateur et transmis
simultanément sur le même canal radio (par exemple, cinq codes sont nécessaires
pour supporter un débit de 2 Mbit/sec).
2. Le mode TD/CDMA,
utilisé en TDD (Time domain Duplex, c'est-à-dire multiplexage temporel des deux
sens de transmission sur une même fréquence). Le concept TD/CDMA utilise une
technique d'accès multiple mixte, comprenant une composante AMRT (accès
multiple à répartition dans le temps) fondée sur la trame GSM et une composante
d'étalement de spectre à l'intérieur des intervalles de temps (time slot en
anglais) avec séparation par code (CDMA)., Ainsi une fréquence de trafic est
définie par une fréquence (porteuse), un intervalle de temps et un code. Ce
concept offre une large gamme de débits de service en allouant plusieurs codes
ou plusieurs intervalles de temps à un même utilisateur. Le débit de 2 Mbit/s
peut également être obtenu mais des raisons hautement techniques et complexes
semblent limiter le bon fonctionnement de ce système aux bâtiments et aux petites cellules urbaines.
Le mode FDD est utilisé en priorité dans les bandes appariés (1920-1980 MHz/ 2110-2170 MHz) et le mode TDD (1920-1980 MHz) dans les bandes non appariées (au choix coordination ou non entre utilisateurs).
VII.d.3 - Services.
Le domaine est archi flou. Le succès de
la deuxième génération est plus lié à la normalisation de la première
génération qu’à autre chose (le débit et le service offert ayant peu évolués).
- Les
prévisions montrent qu’en 2010, la moitié des appels se feront par le
filaire. Le mobile devra donc gérer cette augmentation de trafic.
- Le
visiophone permettra de se voir tout en s’appelant. Il faudra changer les
habitudes du consommateur (par exemple le lieu où va se trouver le
bonhomme sera identifiable). Possibilité de visio-conférence et autres
raffineries de ce genre.
- L’agenda
offert par le palm pilot par exemple.
- E mel
et fax rapide.
- Intranet :
Rester connecté au réseau de son entreprise. Très utile cela a le défaut
de multiplier les points d’accès donc les risques de piratages.
- Internet :
Déjà disponible pour les téléphones de la deuxième génération (Wap mis au
point par Nokia ou le GPRS a 300kbits/sec et EDGE a 500kbit/sec), le débit
sera très largement augmenté (de l’ordre de 2 Mbits/sec dans le cas
idéal : déplacement de moins de 10 KM/H dans des zones
limitées ; raté pour les transports).
- Les
ressources Hard seront une besoin d’un ajout de processeur de gestion
d’écran couleur haute résolution, le stockage et la lecture de fichier MP3
(carte son).

- Les
jeux en réseau : mais déjà possible avec un PC, alors…
…Est
ce que le public est prêt à raquer pour les nouveaux services multimédia ?
Enfin l'ouverture commerciale en France
de réseaux UMTS lui semble difficilement envisageable avant 2002, en
particulier en raison de l'état actuel de l'occupation de spectre des
fréquences et des délais pour la disponibilité des équipements liés notamment
au calendrier de normalisation.
VIII Exemples concrets
VIII.a - Commandes AT
|
Actions |
Commandes |
|
Etablir
la communication |
atd112 ; (N° d’urgence, pas
besoin de carte Sim) |
|
Décrocher |
ata |
|
Raccrocher |
ath |
|
Reset soft |
reset (le reset Hard sur la
Demo Board est plus efficace) |
VIII.c – GPS
VIII.c.1 - Théorie
![]() Emission :
Emission :
On a 24 satellites qui tournent autour de la planète, qui délivrent chacun un message de navigation.
Ce message comprend principalement comme information sa position, son almanach, les éphémérides…
Le signal délivré par les satellites est
un multiplexage CDMA (Code Division Multiple Access) à une fréquence L1 de 1,57542MHz (L2 est réservé aux militaires).
La porteuse module le message de
navigation (NAV) lent (50 bits/s) additionné à un PRN plus rapide (1023 bits/ms)
et le tout constitue le message émis.
Chaque satellite possède son
PRN, ce qui permet de personnaliser le message et de l’authentifier.
![]() Réception :
Réception :
Le module STB 5600 couplé au GP6 ![]() réalise la solution soft, Wavecom se charge
de la solution radio.
réalise la solution soft, Wavecom se charge
de la solution radio.
1.
Calage en
fréquence et en phase par le kernel (GP6).
2.
Sur 12
réceptions en parallèle, corrélations entre le signal reçu et un PRN. Si la
puissance du signal en sortie est cohérente, on a identifié le Nav d’un satellite
connu. On peut donc analyser 12 satellites en parallèles.
Modulation
BSK (Binary shift Keying).
VIII.c.2 - Solution ST Microelectronics
La solution ST Microelectronics se
présente en deux composants distincts. Le premier (STB5600) se charge de mettre
en forme le signal descendant afin de fournir au deuxième (ST20GP6) un signal
prêt à être traité.
Construit dans la technologie HSB2 high speed bipolaire, le STB5600 fournit l’interface complète entre l’antenne active et le ST20GP6.
Utilisant une conversion dual qui nécessite seulement un simple filtre passif externe IF le STB5600 fournit la conversion à partir du signal L1 (1575.42 MHz) du GPS et d’ un oscillateur local de 81.84 MHz.
Ainsi un premier soustracteur (on soustrait L1 à l’harmonique 19 de l’oscillateur) inclus dans le composant permet de transformer le signal L1 en un signal de 20.46 MHz.
Un deuxième soustracteur associé à un diviseur de fréquence par 5 permet d’obtenir le résultat de 4 MHz nécessaire au deuxième composant.
19 x 81,84.106 = 1554,96 MHz
1575,42.106 – 1554,96.106 = 20,46
MHz
81.84.106 /5 = 16.368 MHz
20.46.106 – 16.368.106 = 4.092 MHz
Un avantage important est que le couple STB5600/ST20GP6 tolère plus de +/-132kHz d’erreur de fréquence.
Ceci permet l’utilisation d’un Quartz (81.84 MHz) peu chère à la place d’un dispositif complexe nécessitant la gestion en température sans dégrader la performance TTFF (Time to First Fix).
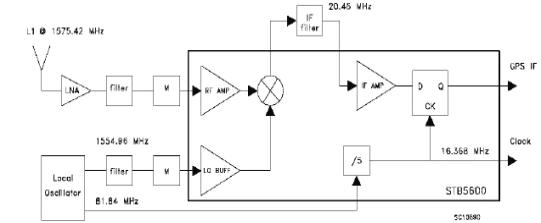
Le ST20GP6 est un microcontrôleur dédié
au GPS basé sur le ST20GP1 solution depuis 1996. Axé sur la technologie 0.35µ
HCMOS le ST20GP6 est rapide et inclus les 128kbyte mask ROM et autres 64kbyte
SRAM éliminant l’utilisation de mémoires externes.
Le 32-bit RISC-like CPU est accompagné
par un DSP dédié qui réalise la corrélation des 12 canaux GPS.
Sont intégrés aussi dans le ST20GP6, les
ports parallèles et séries I/O, gestion d’interruption et les contrôleurs de
diagnostiques, le watch dog, l’horloge temps réel et l’alarme.
Une nouvelle évolution du logiciel
embarqué est attendu qui a pour but de minimiser l’influence des satellites
présentant une mauvaise résolution de position.
VIII.c.3- Tests
Via le port NMEA :
Via l’interface VisualGps ou HyperTerminal (COM1, 19200Bds pour le côté ST et COM1 4800 bauds (par défaut, 19200 si le cavalier est placé sur la démo-board) pour le côté RF, nous visualisons les données NMEA suivantes :
Horaire
mesure Position Altitude
$GPGGA,091426.000,4849.547,N,00216.197,E,1,07,1.1,48.7,M,47.3,M,,,*49
$GPVTG,49.2,T,,M,0.2,N,0.3,K*5E
$GPGSA,A,3,25,09,30,05,06,24,04,,,,,,2.0,1.1,1.7*3A
$GPGSV,2,1,07,04,18,045,45,05,61,073,50,06,42,199,47,09,24,135,47*7A
$GPGSV,2,2,07,24,27,087,45,25,22,307,44,30,74,290,49,,,,*46
Position 3D
Numéro du satellite
Nombre de satellites reconnus.
Puissance des satellites en réception (2digits après le numéro
du satellite)
Position latitude
48"49.547 Nord longitude
2"16.197 Est
Horaire Temps
universel 9h 14mn 26 s
· GPGGA - Global Positioning System Fix
Data
· GPGSA - GNSS DOP and Active
Satellites
· GPGSV - GNSS Satellites in View
Le positionnement 3D permet au système de se positionner dans l’espace. (Minimun 3 satellites reconnus).
Informations complémentaires :
NCO –86505 Fréquence d’erreur du signal H19 /
attendu en Hz.
hd 3 sat 6 tow 200928 health 0 Satellite
identifié
Week 1063 Semaine lors de la mesure
Candidate Time Set
hd 3 sat 17 tow 200928 health 0
Week 1063
Candidate 2 matches found
hd 3 sat 25 tow 200928 health 0
Week 1063
Candidate 3
matches found Les satellites 6, 17, 25
ont été identifiés
GPS time error 0.000484
Posn Status : POS_3D Diff Status DIFF_OFF
Calculated DOPs p 1.79, h 0.96, v 1.51
POSITION
SHIFT: 0.28 -0.81 0.83, dt : 0.67 résolution de la position
P Res : 0.5
5.6 0.9 -6.8 -3.8 -0.2 4.7 -0.8
V Res : -0.03
0.03 -0.03 0.01 -0.00 0.01 -0.02 0.02
Lat : 48:49.546 N coordonnees
Long :
002:16.199 E
Height : 124
Vel : N -0.021
E 0.030 V -0.044
GPS Week 1063 Time 200925.51
07:48:45
on 23/05/2000
|
Sat |
State |
timer |
Freq |
Pred |
PhErr |
SnrI |
cn0 |
cn0log |
type |
Azimth |
Elev |
|
6 |
9 |
1270 |
-88612 |
9 |
9346 |
34500 |
41014 |
46.1 |
E(70) |
67 |
47 |
|
17 |
9 |
1270 |
-85122 |
9 |
9304 |
40500 |
67416 |
48.3 |
E(149) |
132 |
59 |
|
25 |
9 |
1270 |
-88869 |
10 |
8965 |
41000 |
49705 |
47.0 |
E(228) |
218 |
39 |
|
22 |
9 |
1270 |
-84152 |
9 |
8974 |
36500 |
52980 |
47.2 |
E(130) |
299 |
43 |
|
30 |
9 |
1270 |
-89900 |
9 |
9137 |
30500 |
34828 |
45.4 |
E(208) |
123 |
21 |
|
10 |
9 |
1270 |
-87073 |
9 |
9237 |
21500 |
18553 |
42.7 |
E(153) |
41 |
13 |
|
1 |
9 |
1270 |
-87713 |
9 |
9193 |
16500 |
10560 |
40.2 |
E(206) |
305 |
7 |
|
3 |
9 |
1270 |
-83288 |
10 |
9147 |
21500 |
17118 |
42.3 |
E(160) |
258 |
14 |
channel idle
channel idle
channel idle
channel idle
Azimuth 0 -> 90 NE, 90
->180 SE, 180 -> 270 SW, 270 ->0 NW
Cn0log =SNR attendu = ~50
IX Conclusion
Le réseau GSM est considéré par les
spécialistes comme une révolution dans le domaine des télécommunications. Cette
deuxième révolution, après celle du réseau analogique Radiocom 2000, a su se
faire apprécier du grand public en proposant une bonne qualité de service à un
tarif accessible.
Actuellement l'extension de la norme dans
la bande spectrale des 1800 MHz qui se surajoute à la bande des 900 MHz
augmente les performances de ce système.
Les réseaux de 3ème génération peuvent
concilier les avantages de deux nouvelles techniques:
![]() les
nano-cellules couvrant la superficie d'un immeuble et bien entendu localisées
dans des zones très fortement peuplées,
les
nano-cellules couvrant la superficie d'un immeuble et bien entendu localisées
dans des zones très fortement peuplées,
![]() la
couverture satellite en basse orbite pour les zones très faiblement peuplées ou
désertiques.
la
couverture satellite en basse orbite pour les zones très faiblement peuplées ou
désertiques.
On peut par exemple citer le projet
Iridium financé par un consortium dirigé par Motorola qui projette de mettre
environ 70 satellites en orbite pour assurer une couverture de téléphonie
portative au niveau mondial (dépôt de bilan en mars 2000).
La téléphonie mobile sera alors
réellement devenue universelle, au point que certains pensent déjà que les
jours du téléphone fixe sont comptés…
Quelques
chiffres du marché Français au 30 avril 1999
Evolution du nombre d'abonnés en France
par opérateur en France

Chiffres au 30 avril 1999
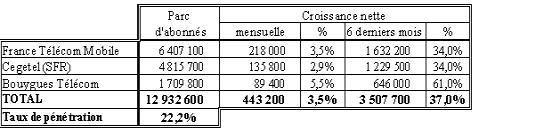
Source
ART
Mais la France n’a beau être le centre du
monde, le marché européen est leader dans ce domaine et seul l’Asie semble
devoir assurer dans le future le leadership. Logique vu que l’objectif est un
taux de pénétration de 100% et que l’Asie est nettement plus peuplé.

Enfin
pour finir, le classement des plus gros fournisseurs de téléphones mobiles, je
crois que je vais me mettre au finlandais

Je voudrais remercier tous les auteurs, éditeurs, ouvriers, techniciens, employés, ingénieurs, commerciaux qui ont permis l’élaboration de ce document.
BigRem – L’artificier Inc 2000.
